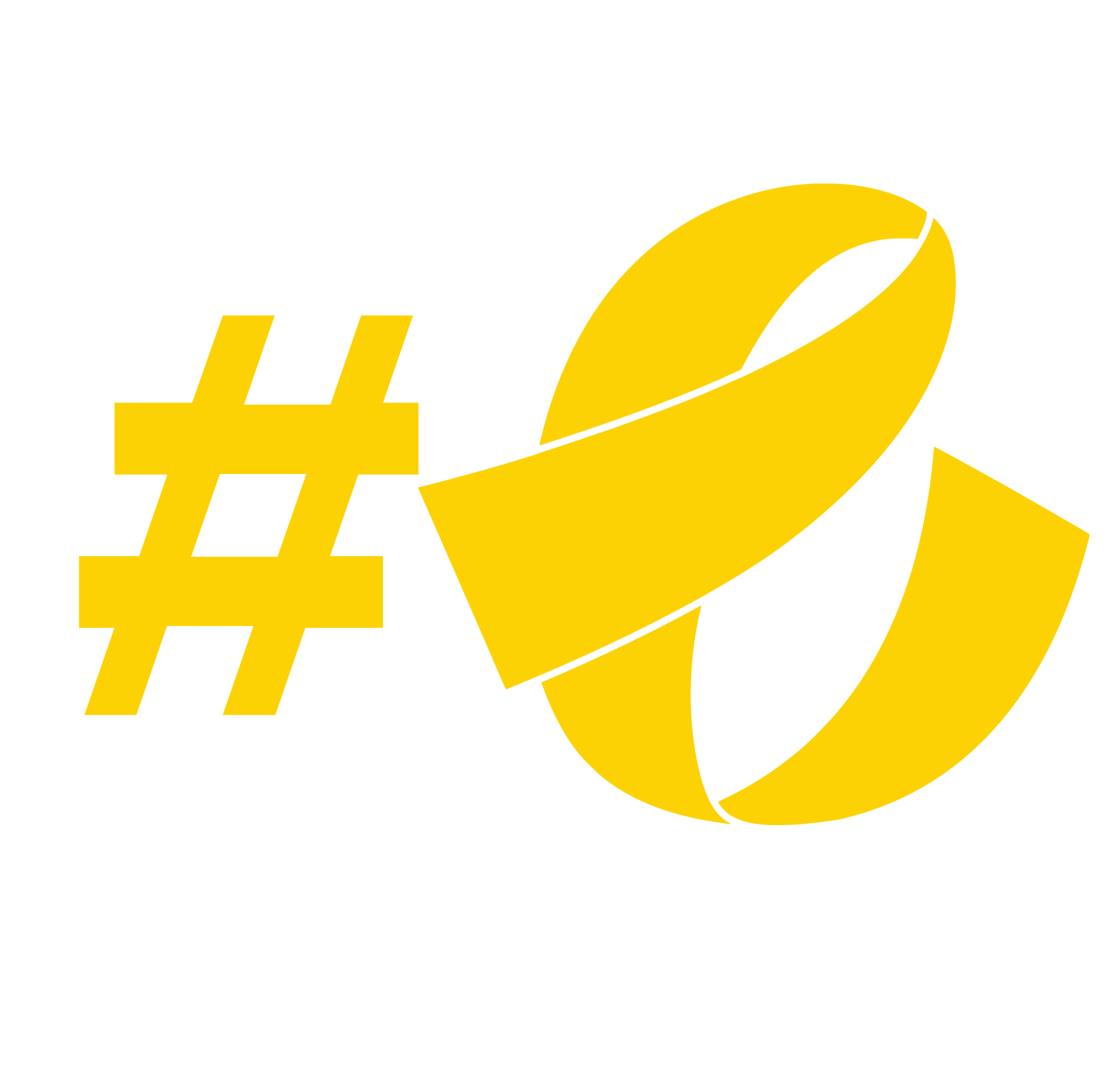La perception de l’endométriose dans l’art avec Corinne Szabo, historienne de l'art et plasticienne

Corinne Szabo, historienne de l’art et plasticienne, se concentre depuis des années sur notre mémoire collective et pour cette exposition sur la manière dont la maladie de l’endométriose est retranscrite dans l’art depuis l’Antiquité. L’artiste nous offre une occasion précieuse de mieux comprendre la vision de la maladie et, plus généralement, de la représentation du corps des femmes, grâce à une approche analytique de l’histoire de l’art, des sciences, et de la philosophie. Cette interview s’inscrit dans le cadre du projet européen #ENDOs, porté par Le LABA et réunissant 9 partenaires de 5 pays différents dans l’optique d’apporter de la visibilité sur l’endométriose et d’encourager l’autonomisation des femmes atteintes de cette maladie.
Pourriez vous vous présenter en une phrase ?
Je suis artiste et historienne de l’art, et j’enseigne cette belle discipline dans les classes préparatoires aux grandes écoles en France, notamment celles qui préparent à l’entrée de l’École Normale Supérieure ou de l’Ecole du Louvre. Mes travaux sont le prolongement des recherches que je mène avec mes étudiants, tout en étant un espace de transmission. En tant qu’artiste et historienne de l’art, ces recherches portent sur les représentations archaïques du monde, abordant des concepts aussi variés que la nature, la sexualité ou encore l’idée de beauté véhiculée par les arts et notre culture.
Comment est-ce que le travail d’historien de l’art éclaire la perception du corps féminin à travers les âges et les époques ?
Que l’on soit historien de l’art ou artiste, on examine les œuvres d’art, qui sont des manifestations visuelles de la pensée de chaque époque. En observant les œuvres de chaque siècle, on constate en effet qu’elles reflètent les philosophies, les sciences et la pensée de leur temps. De l’Antiquité à nos jours, ou du moins jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, on peut déceler, à travers les textes d’Aristote, Platon, Gallien ou encore Hippocrate, notre premier médecin, l’idée d’une infériorité féminine. Hippocrate a été le premier à établir une distinction genrée entre le corps masculin et le corps féminin et a fait de la femme une figure inférieure, marquée par une froideur et une humidité constantes. Cette distinction humorale [Ndlr : relatif aux liquides organiques des corps vivants] a défini la perception du « sexe faible » et a perduré jusqu’au XIXe siècle.
Quels sont les archétypes les plus persistants depuis l’Antiquité, si vous deviez en citer deux ou trois ?
Au niveau de la forme plastique, on retrouve cette distinction genrée. L’Antiquité a créé une différenciation idéologique et organique entre le masculin et le féminin.
Le masculin est souvent associé à des formes pointues, dures et droites, qui incarnent la vérité, tandis que le féminin est lié à la mollesse et à la dissimulation. L’historien de l’art Kenneth Clark illustre bien ces différences. Selon lui, le nu masculin, tel que le « David » de Michel-Ange, est fier de sa nudité car il incarne la raison, la force et le courage. En revanche, les représentations féminines, comme la « Vénus » de Botticelli, sont souvent des figures qui se cachent, associées à la nudité, un corps que l’on désire ou que l’on souille. Le masculin incarne la vérité, la profondeur, tandis que le féminin est lié l’apparence, au mensonge, à la superficialité. Ce schéma se retrouve à travers l’histoire de l’art, notamment dans le néo-classicisme avec des peintres comme David. Dans « Le Serment des Horaces », par exemple, les hommes sont représentés avec des formes phalliques et dures, tandis que les femmes sont prostrées, incapables de maîtriser leurs émotions.
Et de quelle manière, selon vous, ces représentations du corps féminin dans l’histoire ont- elles une influence sur notre perception, notamment des maladies liées aux femmes comme l’ endométriose aujourd’hui ?
Les sciences médicales, de l’Antiquité jusqu’au XVIIe et XVIIIe siècles, ont profondément influencé notre inconscient collectif. Le sexe féminin, historiquement perçu comme une imperfection, est encouragé par la religion qui a fait d’Ève la pécheresse, incarnation de la déraison, de la folie et de la non-maîtrise de soi.
Au XIXe siècle, la femme devient l’incarnation de l’hystérie. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le terme grec pour l’utérus, « hysterica », a donné naissance au mot « hystérique ». Le corps féminin a toujours été jugé déficient, et s’il est un corps incontrôlable, cette perception explique pourquoi des maladies comme l’endométriose ne sont pas prises au sérieux. Ces idées sont profondément ancrées dans notre mémoire collective et il est difficile de prendre du recul face à ces concepts scientifiques hérités de l’Antiquité.
Selon vous aujourd’hui, de quelle manière l’art peut jouer un rôle dans la sensibilisation des publics à ces expériences corporelles féminines, à un changement de perception sur les corps féminins ?
L’art est un puissant médiateur. Les artistes ont un rôle crucial à jouer : ils doivent véhiculer des idées et corriger les zones d’ombre de l’histoire. À mon sens, l’art a pour mission de révéler une certaine vérité, de dévoiler ce qui est caché. L’art n’est pas un simple élément décoratif ni un spectacle, c’est un espace intellectuel qui délivre un message important. Je crois que le spectateur doit faire un effort pour comprendre ce que l’artiste veut dire et réfléchir à son message. L’art est une affaire sérieuse, et il doit être perçu comme un vecteur de transmission.
Quel message souhaiteriez-vous faire passer en participant à cette exposition (exposition en ligne du musée de l’histoire des femmes à Stockholm) en ligne ? Quelle peut être la portée de ce genre d’exposition de contenu auprès du public?
Les œuvres présentées doivent éveiller le public, dépasser la superficialité de notre monde et les lieux communs. Elles (les œuvres de l’exposition) doivent être suffisamment puissantes pour faire comprendre au spectateur que l’endométriose est une maladie grave et qu’il est temps de corriger son invisibilité.
Pour cette première exposition portant sur l’endométriose, j’ai créé une installation murale avec un papier peint réalisé à partir des fleurs de Robert Mapplethorpe. Dans l’histoire de l’art, la fleur est souvent une métonymie du vagin, avec ses connotations d’humidité et d’instabilité. J’ai également détourné des étagères de Haim Steinbach (artiste américain dont les objets masculins et phalliques sont simplement posés sur des socles), sur lesquelles j’ai disposé un ensemble de vases colorés, dont celui que j’ai réalisé avec le souffleur de verre Allain Guillot, le « Vase de Freud », qui incarnent les conceptions vaginales des récepteurs de la “bonne semence”. Ces vases, les vraies fleurs, l’eau, le papier peint à fleurs avaient pour intention de créer ainsi une mise en abîme du propos : le corps féminin comme entité humorale et déficiente.
Une citation de Montaigne matérialisée avec mes étudiants sous forme de néons nous dit que ‘l’usage nous dérobe le vrai visage des choses’. Nos habitudes, notre inconscient collectif et notre mémoire nous font croire en des choses fausses. L’œuvre d’art doit parvenir à nous transmettre une forme de vérité.
Pour en savoir plus sur le projet : www.endostories.eu
Les partenaires du projet :
Le LABA, Vulgaroo (Bordeaux, France), L’Agence créative (Bordeaux, France), Endométriose Academy (Bordeaux, France), Momentum Educate + Innovate (Irelande), University of Turku (Finlande), Stockholms Kvinnohistoriska (Suède), Università degli studi di Palermo (Italie), National University of Ireland Maynooth (Irelande), Digital Narrative Medicine (Italie)